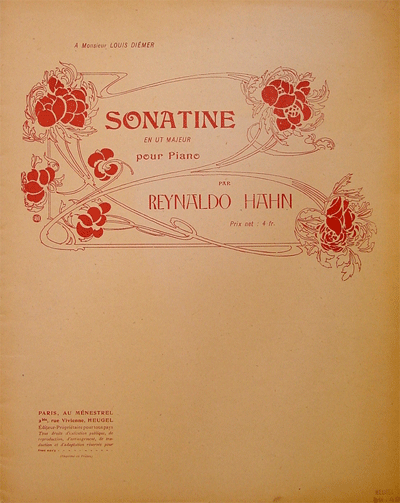
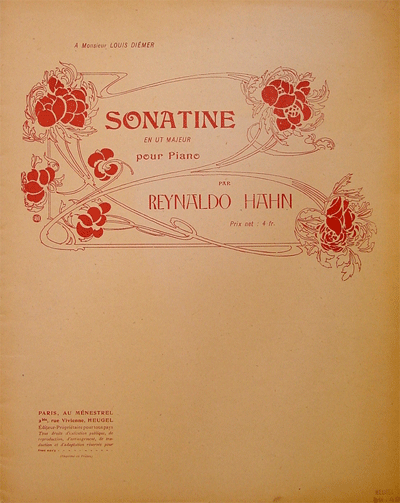
Avec cette œuvre de 1907 Reynaldo s'attaque pour la première fois à la grande forme, attaque bien timide car, à l'instar de Ravel qui l'a précédé en 1905, il donne à son œuvre le titre plus modeste de " Sonatine ". Il est vrai qu'à part Dukas dont la gigantesque Sonate date de 1900, peu de compositeurs français de cette époque ont osé se mesurer aux dernières sonates de Beethoven.
L'œuvre
de Reynaldo sera créée par son dédicataire, Louis Diémer, puis reprise par Magda
Tagliaferro en 1935 lors d'un festival Reynaldo Hahn à la Salle Gaveau; elle
comprend, comme celle de son illustre devancier Ravel, trois mouvements: un
allegro moderato de forme sonate, un andantino rubato avec variations et un
final en forme de tambourin.
Le titre du final prouve dés l'abord. que cette œuvre est encore un pastiche,
genre cher à Reynaldo.
 En cette même année 1907 il a composé les " Chansons et madrigaux "
pour chœur mixte a cappella dans l'esprit de la Renaissance; si l'on ajoute
que Reynaldo a écrit en 1901 un " Mistère " (sic) intitulé " Pastorale
de Noël ", il est clair que l'esthétique de " retour au passé "
qui l'anima dés 1896 est loin d'être abandonnée.
En cette même année 1907 il a composé les " Chansons et madrigaux "
pour chœur mixte a cappella dans l'esprit de la Renaissance; si l'on ajoute
que Reynaldo a écrit en 1901 un " Mistère " (sic) intitulé " Pastorale
de Noël ", il est clair que l'esthétique de " retour au passé "
qui l'anima dés 1896 est loin d'être abandonnée.
![]()
1- Allegro moderato (Do)
Les
rapports de tonalités exigés par la forme sonate ne sont pas entièrement respectés
dans ce premier mouvement, mais, en 1907, cette liberté est loin d'être une
innovation.
La tonalité de Do est affirmée avec force dés l'entrée par un thème basé sur
l'arpège de tonique.
L'antécédent, en deux mesures, commence par un canon à l'octave affirmant dés
le début de la pièce l'importance que jouera dans toute l'œuvre ce principe
contrapuntique. L'écriture presque exclusivement à deux voix, la rythmique carrée
et l'harmonie claire teintée de modalité témoignent d'un souci de simplicité,
voire de dépouillement, qui surprend chez Reynaldo.
Au conséquent, également en deux mesures, succède une reprise du thème oui module
au ton de la dominante.

![]()
Un élément secondaire a2 oppose au staccato de a1 une idée mélodique
legato caractérisée par des sauts de septième et de neuvième et par une écriture
canonique stricte

![]()
a1 est repris, évoluant de Do à Sol.
Le pont modulant est basé sur un motif de marche et sur des rappels de a1.
Le
second thème B est en la, relatif mineur de Do; il oppose au caractère
fortement rythmique du premier thème une ligne mélodique liée et chantante au
parfum délicatement modal (abandon de la note sensible: mode de la)
Les huit mesures de ce thème sont réparties en un antécédent (avec formule de
question et réponse à la quinte) et un conséquent (sous forme de marche) de
quatre mesures chacun

![]()
Dans la section centrale de cette forme allegro de sonate, plus que
d'un développement il s'agit d'un retour des différents éléments entendus dans
l'exposition transposés mais non pas modifiés.
a2 revient en Sol puis en Do, ensuite a1 suivi de l'élément du
pont puis de nouveau a1 et a2 et enfin B.
La
réexposition reprend classiquement le premier thème dans le ton principal (l'élément a2 est omis). Le pont est repris, conduisant cette fois en ré, ton dans
lequel sera repris B (alors qu'il aurait dû être réexposé en Do).
La fin du mouvement, que l'on peut considérer comme un développement terminal,
n'utilise que des éléments du premier thème.
La coda, basée sur un élément issu du conséquent de a1, achève la pièce
dans un mouvement d'accélération progressive.
2- Andantino rubato (Sol)
Le
thème, de coupe ternaire ABA, est suivi de quatre variations qui respectent
ses carrures très régulières (périodes de quatre mesures).
Il déroule une ligne mélodique volubile et continue présentant un embryon de
canon et soutenu par des tierces parallèles
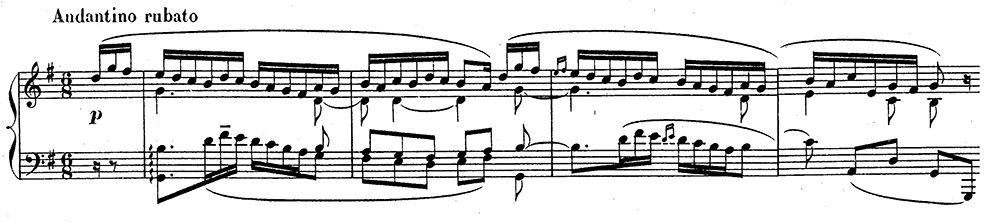
Cette variation ornementale, dans l'esprit des doubles des clavecinistes, monnaye en triples croches le thème qui était en doubles croches. Les carrures et l'harmonie du thème sont respectées sans aucune modification.
Cette variation " rythmo‑mélodique " présente le thème dans un mouvement continu de triolets de doubles croches alternées entre les deux mains.
Elle est écrite dans le ton mineur homonyme (sol). Au caractère très décoratif du thème elle oppose un rythme régulier de barcarolle. L'accompagnement superpose des sixtes parallèles, une pédale de tonique syncopée et, dans la reprise de A, une pédale de dominante également syncopée.
Cette
variation, par la technique digitale qu'elle exige de l'interprète, rappelle
la première de la série; ici chaque note du thème est brodée dans un mouvement
continu de triolets de triples croches
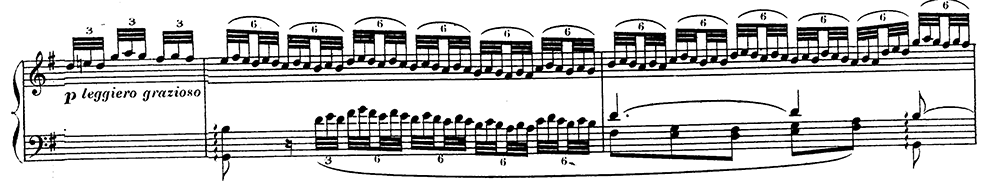
Une coda de quatre mesures achève ce mouvement par une formule cadencielle
sur le principe des notes brodées.
3- Final (en forme de tambourin) (Do)
Pour
conclure cette œuvre d'un charme si typiquement français, Reynaldo emprunte
au XVIII° siècle une danse vive et gaie de forme ternaire que Rameau apprécia
tout particulièrement; à part le célèbre tambourin oui figure dans le " Livre
de clavecin ", on peut citer bon nombre de ces danses incluses dans ses
œuvres lyriques.
Deux tambourins figurent dans la première entrée des " Fêtes d'Hébé ". (1)
Ces danses font succéder un épisode en majeur, une seconde partie dans le ton
homonyme mineur et la reprise de la première section; Reynaldo a suivi ce schéma.
Bizet avait, en 1872, inclus un " Tambourin " dans sa musique de scène
de " L'Arlésienne ".
A- Cette première section est basée sur deux éléments
thématiques: a1 est caractérisé par l'élan donné par un départ en anacrouse
et une formule de broderie de la tonique et de la dominante
 |
|
| a2 présente, dans une stricte écriture à deux parties, des marches et des rythmes irrationnels (quintolets) | |
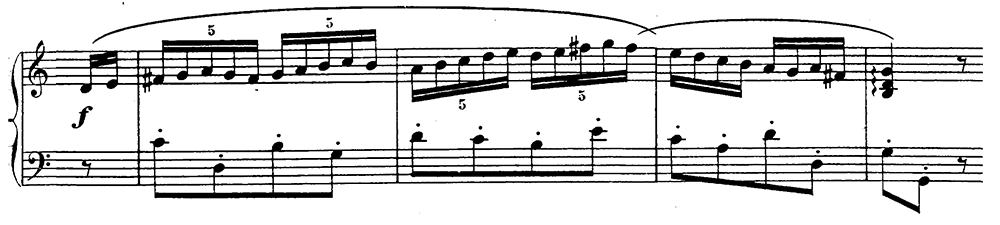 |
Ces deux éléments alternent, modulant dans les tons voisins puis revenant au ton principal.
B-
Comme nous
l'avons vu chez Rameau cette partie centrale est dans la tonalité mineure homonyme
(do).
La notation donne l'impression d'un tempo plus lent (aux croches et doubles
croches de A correspondent ici des noires et des croches). Le thème de caractère
dansant et léger (entièrement basé sur une rythmique de dactyle) est placé sur
pédale. Son écriture grêle regroupée dans l'aigu du piano, son abondante ornementation
(trilles et mordants) rappelle le clavecin.
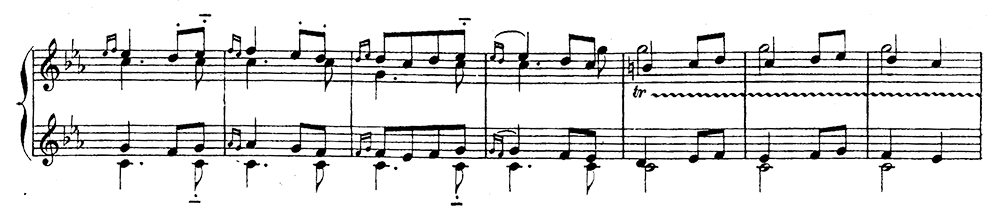
![]()
A- La reprise de la première partie n'apporte aucune modification.
Une coda de huit mesures sous forme d'arpèges de tonique et de dominante puis de sixtes parallèles met un brillant point final à cet aimable pastiche.
partition disponible à la vente chez Leduc :
HE 33888 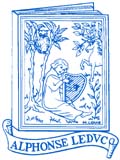
(1) Jean-Philippe Rameau : Les Fêtes d'Hébé, partition piano et chant, Paris‑ Durand p. 74,75 et111

Loading
|

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.