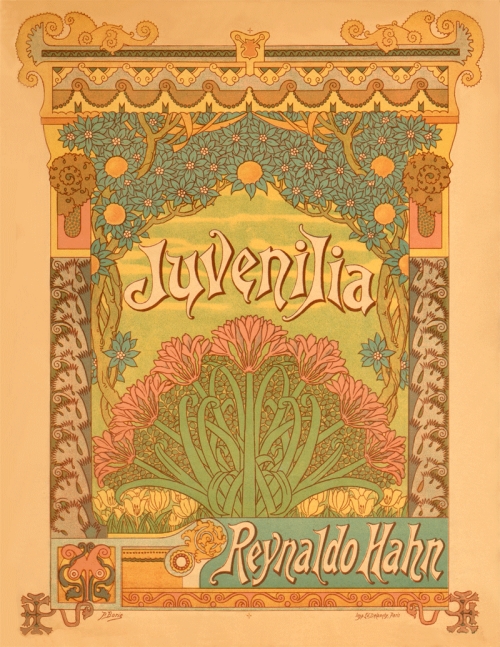
Ce
recueil de six pièces s'échelonne entre la quinzième et la dix-huitième année
du compositeur; chaque pièce est datée et indique le lieu de composition.
1- Portrait (Paris 1891)
2- La promenade (Saint-Germain, 1893)
3- Demi-sommeil (Territet, 1890)
4- Feuillage (Forêt de Saint-Germain, 1893)
5- Phœbé (Octobre 1893, promenade du soir dans la campagne en Angleterre)
6-
Les regards amoureux (9 Juillet 1891, Münster-am-Stein)
![]()
1- Portrait (Paris 1891)
Il
s'agit peut-être du portrait de Cléo de Mérode, danseuse que Reynaldo
rencontra alors qu'il avait quinze ans et qui lui inspira jusqu'à sa mort "une
passion chaste". [1]
Écoutons parler Cléo de Mérode dont les propos sont rapportés par M. Bernard Gavoty :
" ... s'étant rendu compte de ma passion pour la musique, il apporte
ses œuvres à L'opéra, au fur et à mesure qu'il les écrit; pendant les pauses
des répétitions, nous allons au foyer du chant; là, il se met au piano et interprète
pour moi seule ses compositions. Chaque fois, il m'en offre les manuscrits. "
[2]
Ce "Portrait" est peut-être l'une des œuvres qu'il offrit à sa jeune amie.
Il
s'agit d'une courte pièce basée sur deux éléments mélodiques alternant sur un
accompagnement immuable syncopé formant double-pédale de tonique et dominante.
![]()

2-
La promenade
(Saint-Germain, 1893)
![]()
Cette
pièce fut composée dans la forêt de Saint-Germain, au "Pavillon Louis XIV" qui appartenait à Clarita Seminario,
sœur de Reynaldo; elle porte en exergue une phrase de Molière : " La
campagne à présent n'est pas beaucoup fleurie "
Comme dans le numéro précédent on devine dans cette pièce le talent du jeune
improvisateur dont Joseph Morpain,
qui fut son camarade dans la classe d'Émile
Descombes nous apporte une preuve
:
" Lorsque Descombes, qui nous entraînait régulièrement à la lecture
musicale par des concours nombreux, manquait de manuscrits, il se tournait vers
notre ami; -Reynaldo, écris nous quelque chose. Reynaldo s'installait devant
une page blanche et, dix minutes plus tard, nous commencions le concours. Nous
n'avions jamais à nous plaindre: c'était charmant. "
[3]
Cette
pièce est construite sur trois motifs thématiques qui, selon un procédé cher
à Reynaldo, oppose les rythmiques binaire et ternaire.

![]()
![]()
Plus développée que la pièce précédente, elle souffre de redites et de procédés
de remplissage trop simplistes (transposition d'un motif entier à la dominante
sans autre modification).
3-
Demi-sommeil
(Territet, 1890)
![]()
C'est
la pièce la plus ancienne du recueil et, de loin, la plus originale; Reynaldo
qui est si exigent envers lui‑même s'accorde pour une fois un satisfecit
:
" Ce morceau est mieux que je ne pensais et, en somme, ne rend pas mal
ce que je voulais. Il est d'un vague assez réussi et l'on distingue pourtant
des contours et des mouvements. Ce que je craignais de ne pouvoir obtenir, je
crois l'avoir parfois obtenu: une coulée de sonorités. "
[4]
Cette pièce porte en exergue une phrase de
Chateaubriand : " Je m'endormis;
mon repos flottait sur un fond vague d'espérance... " (Mémoires d'Outre-Tombe).
Ces
deux pages athématiques consistent en une recherches de sonorités harmoniques
expressives.
Dans la nuance PPP deux notes sont égrenées sur toute l'étendue du clavier pendant
dix mesures: la et mi (tonique et dominante du ton la), ce mouvement calme,
symbolisant le sommeil, durera tout le long de la pièce.
A partir de la mesure 11 commence le jeu de recherches harmoniques: une note
est tenue tandis que le mouvement continue, imperturbable; cette note, sol, établit un frottement avec le la de l'arpège. Deux mesures plus loin c'est do
dièse qui est tenu: on entend alors l'accord de septième de dominante en ré.
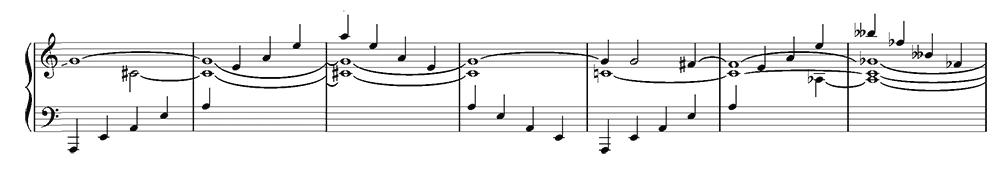
![]()
![]()
Toute la pièce est basée sur ce système: la main gauche poursuit un mouvement
régulier de noires tandis que la droite tient des notes qui, lentement, une
à une, se transforment, changeant sans cesse la couleur harmonique; c'est une
évolution perpétuelle qui pourrait se poursuivre indéfiniment mais qui retourne
bientôt à la nudité initiale de tonique et dominante (forme en arche).
Une telle pièce est très étonnante sous la plume d'un jeune garçon de quinze ans, élève de Massenet qui plus est !
4-
Feuillage (Forêt de Saint-Germain, 1893)
![]()
 Avec
cette pièce dédiée à Léon Delafosse nous rejoignons un univers beaucoup plus conventionnel et "salonnard" qui rappelle
tout à fait celui du dédicataire : Léon Delafosse (I874-I95I), présenté par Marcel Proust
au Comte Robert de Montesquiou fut lancé dans la haute société par ce dernier et devint bientôt "le
Paderewski de la rue Tronchet"
(où se situait l'hôtel particulier de la
Comtesse Edmond de Pourtalès);
tous les salons du Faubourg Saint Germain se le disputaient.
Avec
cette pièce dédiée à Léon Delafosse nous rejoignons un univers beaucoup plus conventionnel et "salonnard" qui rappelle
tout à fait celui du dédicataire : Léon Delafosse (I874-I95I), présenté par Marcel Proust
au Comte Robert de Montesquiou fut lancé dans la haute société par ce dernier et devint bientôt "le
Paderewski de la rue Tronchet"
(où se situait l'hôtel particulier de la
Comtesse Edmond de Pourtalès);
tous les salons du Faubourg Saint Germain se le disputaient.
Cette pièce
que Reynaldo lui dédie suit la forme d'un lied ABA et présente quelques
passages très intéressants voisinant avec des motifs beaucoup plus anodins.
Il faut remarquer, dans la deuxième section de A, les accords expressifs
superposés à un mouvement d'arpèges de tonique et de dominante.
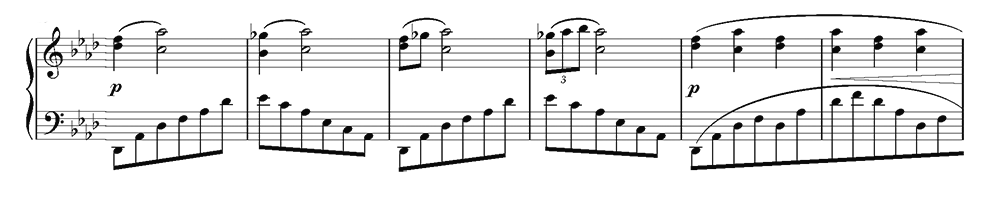
5-
Phœbé (Octobre 1893, promenade du soir dans la campagne en Angleterre)
![]()
![]()
![]()
Cette pièce est la moins intéressante du recueil car elle présente peu d'intérêt
au point de vue mélodique (et c'est la mélodie qui prime chez Reynaldo, surtout
dans les œuvres de jeunesse); l'accompagnement en lourdes batteries réparties
entre les deux mains offre cependant quelques modulations expressives mais ces
dernières n'arrivent pas à donner à l'ensemble un ton convaincant.
A noter dans cette forme lied que la dernière partie, si elle reprend le ton
du début (Si), ne réexpose pas le thème de A mais celui de B.
6-
Les regards amoureux
(9 Juillet 1891, Münster-am-Stein)
![]()
C'est
pendant ce même séjour d'été à Münster-am-Stein que Reynaldo composa les onze
petites pièces qui forment l'illustration musicale du conte "Au
clair de lune", œuvre assez
anodine et d'un intérêt musical bien inférieur à ces "Regards amoureux" qui
témoignent d'une inspiration charmante.
Le caractère sentimental du thème initial avec son chromatisme et son saut de
septième expressifs est accentué par de nombreuses appoggiatures

![]()
![]()
La partie centrale de cette forme ABA par souci d'unité conserve la même
rythmique que le début ; un élément complémentaire, b2, est placé sur
pédale de dominante.
La reprise de A apporte quelques modifications heureuses car inattendues
telle cette brusque modulation de Mi bémol à Sol bémol, vers la fin de la pièce,
qui est du meilleur effet.

Il faut rapprocher ce recueil de "Juvénilia" d'autres œuvres composées
à la même époque: les "Chansons grises" sur des poèmes de Verlaine,
certaines mélodies du premier recueil et surtout l'idylle polynésienne "L'île
du rêve" ; toutes ces œuvres baignent dans la même atmosphère d'ingénuité
tendre et charmante, de grâce mélancolique et nonchalante.
(1)
Bernard Gavoty : op.
cit. p.52
(2) Bernard Gavoty : op. cit. p.51
(3) Bernard Gavoty : op. cit. p.37
(4) Reynaldo Hahn : Notes (Journal d'un musicien)
- Paris : Plon-1933-p.26

Loading
|

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.