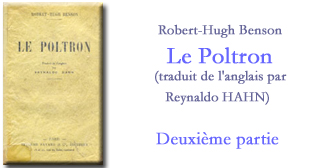 |
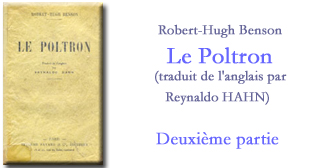 |
CHAPITRE III
L'émoi qu'on appelle " calf-Love " n'est pas seulement très beau; il est parfois singulièrement constant ; et Val emporta à Cambridge une photographie dans un petit médaillon à secret, deux lettres très froissées et un idéal puissant.
L'écriture de Gertie - ferme et plutôt grande - lui était plus chère encore que la photographie : celle-ci reproduisait ses traits, mais l'écriture émanait d'elle-même. Sa main avait reposé sur ce papier, ces petits traits impétueux étaient des signes directs de son état d'âme. Il enveloppa donc le médaillon et les deux lettres, les fit coudre dans un morceau de soie brodée qu'il porta comme un scapulaire, suspendu à son cou par une chaîne. Chaque matin et chaque soir, il embrassait son trésor, et il le tenait entre ses doigts lorsqu'il s'agenouillait près de son lit - car, depuis
Telle était une des manifestations du nouvel idéal qui s'imposait à lui de cent autres façons encore, manifestations qui eussent infiniment étonné Gertie si elle en avait eu connaissance. Bientôt personne au collège n'ignora que Val Medd ne goûtait pas certains genres de conversations, qu'il ne voulait pas jouer plus d'un demi-penny le point au poker, et qu'il risquait absolument de devenir insupportable... Cet idéal régissait toutes choses avec tant d'autorité et de douceur qu'il se fit sentir jusque dans l'assiduité ponctuelle de Medd aux conférences. Certaines gravures disparurent de sa chambre et furent trouvées, par des camarades curieux, entassées sur le haut d'une armoire. Il donnait encore des dîners dans Jésus Lane, mais c'étaient des réunions paisibles et ordonnées. Il fréquentait toujours le Pitt's Club, mais restait moins longtemps à causer adossé à la cheminée ou à feuilleter des magazines dans le salon de lecture.
Intérieurement, il était plus soumis encore à son idéal ; certaines choses lui devinrent impossibles et, parmi celles-là, son ancienne peur de
Entre temps, il employait ses aptitudes diplomatiques à la combinaison d'un très joli petit complot où il joua son rôle avec une adresse remarquable.
Il commença par écrire deux lettres, pendant le carême, à sa sœur May ; dans la première il lui exprimait son remords d'avoir manqué à ses devoirs épistolaires envers elle depuis qu'il avait quitté Eton. Cette première lettre n'était pas préméditée ; à peine avait-il conscience, en l'écrivant, de se trouver en contact plus étroit non avec sa sœur, mais avec l'amie de Gertie. La seconde était dictée pas l'astuce et se terminait par un post-scriptum : " Pourquoi maman ne t'a-t-elle jamais laissé voyager à l'étranger ? Si elle s'y décidait, je t'accompagnerais, quand tu voudrais. "
Ceci, comme bien l'on pense, provoqua chez May un débordement de lamentations : " II était trop injuste, écrivait-elle, que les garçons fussent toujours les mieux partagés en tout... " Alors, Val démasqua une de ses batteries ; il répondit " qu'il croyait que Rome, au moment de Pâques, ce devait être absolument charmant, qu'il se demandait pourquoi lui et May n'iraient pas y passer quinze jours pendant les vacances, et que May devrait bien tater le terrain... "
La correspondance, après cette lettre, subit un temps d'arrêt, pendant lequel Val, chaque jour, vit s'éteindre et se rallumer son espoir. Mais ses intuitions avaient été justes, ses jalons admirablement posés. A n'en pas douter, on estimerait préférable que May ne fût pas la seule jeune fille du voyage et Gertie Marjoribanks, qui parlait fort bien l'italien et le français, était la compagne rêvée, Donc, dix jour exactement après que les adroites incitations de Val eurent quitté la boîte aux lettres du Pitt's Club, il souriait un matin, tout en prenant un air préoccupé, en déjeunant avec son camarade Jim Waterbury qui s'indignait de son silence : c'est que là, sur la table, gisait une lettre de May qu'il venait de recevoir. La jeune fille s'y épanchait en torrents de joie et d'enthousiasme, et annonçait à son frère que le lundi des Rameaux, elle, lui et Gertie Marjoribanks partiraient pour Rome. Un seul petit nuage ternissait, pour Val, la limpidité du ciel : la possibilité, mentionnée par le post-scriptum, qu'Austin fût aussi de la partie.
Toutefois, il n'y attacha pas grande importance. Austin lui-même ne pouvait détruire ce bonheur : un voyage de quinze jours en compagnie de Gertie. Et elle irait à Medhurst en été, puis à
Le mystère ajoutait un charme de plus à l'affaire. Ils avaient décidé, prudemment, de ne s'écrire que toutes les six semaines. Et ce silence était délicieux, ce silence partagé par deux cours exultants qui ne laissaient rien paraître de leur allégresse.
II
L'état d'âme de Gertie est plus difficile à décrire, à cause de sa complexité. Chez Val, un seul fait et rougi à blanc : l'amour d'un jeune homme pour la jeune fille qu'il avait choisie, amour que raffinaient au suprême degré le romanesque, l'éducation, l'hérédité, flamme pure décelant la qualité très simple du combustible. Mais la jeune fille, bien que plus jeune, était non seulement plus complexe, mais encore bien plus expérimentée. La musique et la comédie de salon, ses principales occupations jusque-là, avaient agrandi le champ de son imagination en même temps que développé sa capacité de sentir. Les deux cours étaient, l'un par rapport à l'autre, comme un violon et un archet. C'est dans le violon que réside la musique, depuis le cri suraigu de la chanterelle jusqu'au langoureux murmure de la corde la plus grave. Et quand l'archet frémit d'extase au contact des cordes, c'est d'une seule extase et non de mille. Certes, la musique s'exhalait du violon, appelée par l'archet ; certes, Gertie répondait à Val, et Val créait le prodige sonore ; mais il n'en est pas moins vrai que la musique gisait bien dans le violon et que si Gertie chantait, maintenant et de tout son cœur, la chanson de Val, elle était capable de chanter aussi d'autres mélodies. Que l'archet vînt à se briser, on pourrait en faire un autre ; mais que ce fût le violon, et l'on ne trouverait pas un instrument identique à lui substituer.
Gertie avait devant les yeux un aspect particulier de Val, devant lequel son être s'inclinait, sincèrement, ardemment. Dans l'intimité de Medhurst, elle s'était accoutumée au jeune homme ; par delà les maladresses superficielles qui, en d'autres circonstances, eussent peut-être faussé sa clairvoyance, elle avait perçu un élément de ce caractère - les facultés romanesques et imaginatives - auquel il lui semblait que l'extérieur de Val correspondait en tout point. Il avait un visage de preux, grave et candide, nez aquilin, lèvres minces et droites, menton saillant et cheveux frisés ; il était grand, mince et nerveux. Et il avait galopé derrière elle, et il lui avait sauvé
Elle se conduisait, dès lors, comme se conduisent les jeunes filles dans ces cas-là. D'abord, elle avait porté, dans un médaillon, tout contre sa poitrine - comme il portait son scapulaire - la petite bague ornée d'une grosse turquoise qu'il lui avait envoyée. Puis, audacieuse, elle l'avait mise à son doigt. Elle pensait constamment à lui, elle aussi, elle y pensait en s'éveillant, avant de s'endormir ; elle aussi fermait sa porte à clé, quelquefois, éteignait la lumière et rêvait, assise, devant le foyer. Tout cela était parfaitement sincère ; elle aimait à s'imaginer près de lui, lui obéissant, cédant à son influence, s'appuyant sur lui ; elle tenait superbement à distance le vicomte d'âge mûr et se demandait parfois si elle ne laissait pas percer, d'une façon quelconque, un regret caché ; elle faisait de la musique et jouait la comédie avec une véritable ardeur... Elle était le plus souvent silencieuse ; et elle écrivait chaque jour à May, s'imposant de ne nommer Val, dans ses lettres, qu'une fois par quinzaine, environ.
Tout cela était simple et sincère. Amour de pensionnaire sans doute, mais qu'importe ? C'était doux et frais - c'était l'émotion la plus vive qu'elle eût jamais éprouvée. Elle n'y apportait nulle coquetterie ; elle eût souffert de causer du chagrin à Val ; elle était fermement, loyalement résolue à tenir jusqu'à la fin ses engagements envers lui ; elle se voyait sa femme, la mère de ses enfants. Elle se proposait de vieillir, de blanchir au service de son amour et de ressembler exactement, dans trente ans, à lady Béatrice. Et ainsi de suite...
Mais ce qui démontrait sa complexité, c'est que, tout en caressant ces pensées, ces projets, elle ne perdait jamais conscience d'elle-même et qu'elle croyait sa part de contribution plus grande que celle de Val. Chez lui, tous les sentiments s'étaient effacés devant l'amour ; chez elle, ils s'y soumettaient, mais conservaient leur identité. Par exemple, elle se demandait, nous l'avons dit, si, involontairement, elle donnait des signes d'un chagrin secret. (Val, lui, n'avait nul souci de ce genre. Il eût éprouvé une douleur mêlée de honte à la seule pensée qu'une pareille chose pût lui être imputée. Deux mois auparavant, il avait pu avoir de ces doutes : maintenant, toute complication avait disparu de son âme.) Ou bien, encore, Gertie se figurait de petites scènes qui prouvaient qu'elle " savait le prendre ". (Val, lui, ne pensait qu'à une seule chose : à l'aimer.)
Au fond, cela la flattait, dans son esprit féminin, de se pencher sur la chère simplicité de Val. (Alors que celui-ci n'analysait jamais ses qualités à elle ni ses défauts : pour lui elle faisait un tout.) Enfin, elle mesurait l'amour qu'il lui inspirait aux sacrifices qu'elle avait été heureuse de lui faire - le vicomte par exemple ; elle se demandait si
Tels ils étaient l'un et l'autre, séparés par une distance de quatre-vingts milles en tant qu'espace, par une éternité en tant qu'âmes et que sentiments, mais se croyant tous deux étroitement unis. Val, chaque soir, joyeux et méditatif, assis devant son feu, observait en esprit Gertie s'endormant le soir dans sa chambre de jeune fille ; et, chaque soir, Gertie, en s'endormant, se figurait Val assis devant son feu... Deux enfants !
Et maintenant, assez de psychologie.

Loading
|

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.