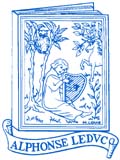Quinze
ans ont passé; Reynaldo est à présent le jeune dandy fêté dans les salons; son
éditeur, Monsieur Heugel,
offre aux lecteurs du "Ménestrel" plusieurs de ces valses qui paraîtront
dans les suppléments d'octobre et novembre 1898.
 Le
recueil se compose de dix valses précédées d'une "Invitation à la valse ".
On peut le rapprocher d'une œuvre de Léon Delafosse (pianiste-compositeur
qui connut une vague immense dans les années 1890-1910 et qui servit de modèle
au Charlie Morel de la "Recherche du temps perdu ", les 12 Valses-Préludes de 1895; la huitième de ces pièces "En cueillant des fleurs" était d'ailleurs
dédiée "à M. Reynaldo Hahn".
Le
recueil se compose de dix valses précédées d'une "Invitation à la valse ".
On peut le rapprocher d'une œuvre de Léon Delafosse (pianiste-compositeur
qui connut une vague immense dans les années 1890-1910 et qui servit de modèle
au Charlie Morel de la "Recherche du temps perdu ", les 12 Valses-Préludes de 1895; la huitième de ces pièces "En cueillant des fleurs" était d'ailleurs
dédiée "à M. Reynaldo Hahn".
La
plupart de ces valses ont été écrites pour des pianistes amis du compositeur;
les deux premières sont par exemple dédiées à
Joseph Morpain qui avait obtenu,
en 1888, une deuxième médaille dans la classe préparatoire de
M. Descombes tandis que son camarade
Reynaldo n'obtenait qu'une troisième médaille.

Invitation à la valse






1-
Valse n° 1
Comme
presque toutes les valses du recueil elle suit la structure tripartite
ABA.
La ligne mélodique chromatique est souple et élégante, l'accompagnement léger,
la langue harmonique encore simple contient cependant des recherches expressives.








Le motif de la partie centrale est issu du début et superpose, comme dans "Invitation à la valse", les rythmiques binaires et ternaires (une des caractéristiques
de l'écriture de R.H.).

2-
Valse n° 2
La
simplicité et la rythmique vigoureuse de la deuxième valse font penser au
Schubert des Danses allemandes.
La section centrale au caractère rythmique accentué (sur pédale de dominante)
s'oppose au début caractérisé par une courbe mélodique simple et gracieuse.







3-
Valse n°3: "Ninette"
La
troisième valse est une danse rapide (à un temps) dans la nuance PP d'un bout
à l'autre. La main gauche, par un léger mouvement de noires staccato, soutient
dans la première partie A un motif rythmique basé sur des accords
répétés, puis dans B un motif mélodique qui module librement.









Dans ces valses la reprise de la première
partie A n'apporte presque jamais de modification.
(N.B.: cette valse parut comme supplément au "Ménestrel" du 23 octobre
1898)

4- Valse
n°4: Valse noble
Reynaldo
Hahn reprend, avant Ravel dont les "Valses nobles et sentimentales" ne datent que de 1911 le terme
schubertien de valse noble. Cette valse est dédiée à
Joseph Morpain.
Le thème, entièrement en octaves et sous forme de marches, est soutenu par des
basses profondes et de grands accords arpégés.







Au caractère héroïque de A,
B oppose une courbe mélodique lyrique jouée par la main gauche dans la nuance
P




5-
Valse n°5
La
Cinquième valse, Reynaldo l'a composée à l'ombre rêveuse de Chopin.
L'atmosphère calme et mélancolique rappelle certains nocturnes du compositeur
polonais plutôt que ses valses dont le côté brillant n'apparaît pas ici.
La pièce est entièrement construite sur pédale de tonique (la). Les courbes
mélodiques sont simples et doivent leur couleur nostalgique à certains emprunts
modaux (la mode de Fa).








6-
Valse n°6
M. Antonin Marmontel est le dédicataire de la sixième valse qui fut publiée comme supplément au "Ménestrel" du 6 novembre 1898.
C'est une pièce rapide sans grande originalité. La section centrale rompt la
rythmique figée du début par un mouvement syncopé qui, en combinant deux mesures
à 3/8 donne l'impression d'une mesure à 3/4:







C'est
une sorte de ralenti écrit. Certaines recherches de coloris harmoniques
agrémentent cette partie B.

7-
Valse n°7: Berceau
Suzette
Lemaire, fille de
Madeleine Lemaire, chez qui Reynaldo
avait rencontré Marcel Proust,
reçoit la dédicace de la septième valse (elle parut dans le "Ménestrel" du 20 novembre 1898)
Tout comme la précédente, elle offre peu d'intérêt; c'est une valse lente dans
le goût de l'époque.
L'écriture est très rudimentaire. Peu d'invention mélodique, très peu de modulations...
Le thème initial s'inspire de la berceuse enfantine "Dodo l'enfant do",
d'où le titre de la pièce.







8-
Valse n°8





La huitième valse, par son caractère héroïque, se rapproche de la Valse noble,
la quatrième du recueil.
Elle est dédiée à Édouard Risler,
autre camarade de Reynaldo dans la classe d'Émile
Descombes qui deviendra un virtuose de grand
renom; il créera plusieurs autres œuvres de son ami.
La partie centrale de cette pièce, grâce à sa courbe mélodique chromatique et
passionnée et à ses modulations expressives, offre un intérêt plus grand que
le début plutôt grandiloquent.

9- Valse
n°9: La feuille
Cette
valse lente très sentimentale et languissante en la bémol est dédiée "à M.
Antonin Marmontel" ; Reynaldo
adore les tonalités dotées d'une riche armure, on retrouvera très souvent dans
ses pièces les tons de Fa dièse, Do bémol, Si...
La partie centrale avec son chant intérieur est dans le ton homonyme majeur
(La bémol).
L'intérêt de cette pièce réside dans l'écriture harmonique qui est très raffinée
(neuvièmes, appoggiatures, etc.)









10-
Valse n°10






La dernière valse du recueil est la plus développée, elle porte en exergue un
vers de Baudelaire :
" ... Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon... "
Cette intervention d'un élément poétique dans l'œuvre musicale est très caractéristique
de Reynaldo Hahn, poète, chanteur et musicien selon la formule employée par Proust dans sa dédicace de la nouvelle "La Mort de Baldassare Silvande" en 1895. Le Rossignol éperdu
marquera un aboutissement de cette poétique musicale.
Cette
dernière pièce est beaucoup plus élaborée que les précédentes et annonce certaines
valses du "Ruban dénoué" de 1915.
La forme-lied est considérablement élargie, l'invention mélodique est abondante
et variée, l'écriture harmonique riche et expressive.
En conclusion, ce recueil qui date de la vingt-troisième année du compositeur,
apparaît comme un parfait témoignage de la vie musicale des salons de la fin
du siècle dernier; ce sont de petites pièces élégantes d'une écriture raffinée
et d'une grande séduction mélodique qui sont destinées à être jouées dans l'intimité amicale d'un salon et non dans une salle de concert comme les valses de Saint-Saëns qui datent de la même
époque.
partition disponible à la vente chez Leduc :
HE 19139 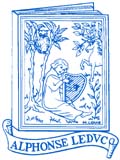
|
|
|



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
|


 Le
recueil se compose de dix valses précédées d'une "Invitation à la valse ".
On peut le rapprocher d'une œuvre de Léon Delafosse (pianiste-compositeur
qui connut une vague immense dans les années 1890-1910 et qui servit de modèle
au Charlie Morel de la "Recherche du temps perdu ", les 12 Valses-Préludes de 1895; la huitième de ces pièces "En cueillant des fleurs" était d'ailleurs
dédiée "à M. Reynaldo Hahn".
Le
recueil se compose de dix valses précédées d'une "Invitation à la valse ".
On peut le rapprocher d'une œuvre de Léon Delafosse (pianiste-compositeur
qui connut une vague immense dans les années 1890-1910 et qui servit de modèle
au Charlie Morel de la "Recherche du temps perdu ", les 12 Valses-Préludes de 1895; la huitième de ces pièces "En cueillant des fleurs" était d'ailleurs
dédiée "à M. Reynaldo Hahn".