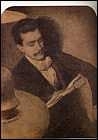
DOUZE STATIONS D'AMITIE
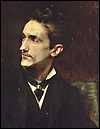
III
CHAPITRE
TROISIÈME
ROMAN
D'AMITIÉ
Je ne vois autour de nous que des Amitiés
froides. C'est que, sans doute, elles tiennent plutôt de ces attachements,
moins sincères et moins entiers, que définit ainsi l'un des philosophes
que nous allons appeler à l'examen de ce sentiment :
" Qu'on ne mette pas à ce rang ces autres
amitiés communes; j'en ai autant de connaissance qu'un autre, et des plus
parfaites de leur genre: mais je ne conseille pas que l'on confonde leurs
règles, on s'y tromperait. Il faut marcher en ces autres amitiés, la
bride à la main, avec prudence et précaution ; la liaison n'est pas nouée
en manière qu'on n'ait aucunement à s'en défier. " Aimez-le, disait Khilon,
comme ayant quelque jour à le hair, haïssez-le comme ayant à l'aimer.
Ce prétexte qui est si abominable en cette souveraine et maîtresse amitié,
il est salubre en l'usage des amitiés ordinaires et coutumières, à l'endroit
desquelles il faut employer le mot qu'Aristote avait très familier: "
O mes amis, il n'y a nul ami ". (Montaigne)
Quoi qu'en dise le même philosophe, les
spécimens d'amitié qui me semblent contenir le plus de chaleur, entre
les exemples offerts à nos yeux par la civilisation contemporaine, sont
ceux qui s'exercent de femme à homme, et réciproquement.
C'est que, sans doute, cette qualité leur
est restée d'avoir effleuré l'amour, et d'être ainsi devenus, non cet
amour finissant en amitié dont l'antiquité nous lègue la formule, appliquée
à des sentiments d'une autre essence; mais un amour se transposant en
amitié. Cet état d'âme entre deux êtres de sexe différent est, en effet,
moins rare qu'on ne pourrait le croire.
Des hésitations sentimentales, des considérations
sociales, des inégalités de tempérament, des fatalités,
des hasards en peuvent être les causes. Encore ne vont-elles pas sans
inspirer à certaines femmes de cœur, parfois d'esprit, un désir de réparation,
de dédommagement, dont elles font bénéficier, sur d'autres terrains, l'homme
qui aurait souhaité, sinon mieux, du moins autre chose. De là, ces amitiés
dont je parlais, non plus amoureuses, mais chaleureuses, palpitantes aussi,
pour contenir, dans leur amalgame, un peu de la flamme d'un Eros brisé,
et de ses ailes. En outre, on peut supposer que l'ère du féminisme à outrance,
a procréé un genre de femme-camarade, moins impropre à cette forme de
sentiment que ne le déclarait l'auteur des Essays.
L'histoire des
amours que nous n'aurons pas eues...
Ce beau vers contient du secret de ces
amis, qui auraient pu être des amants, et des amantes. Noble et triste
vers attribué à ce mysterieux Adrien Juvigny, dont il faut bien espérer
que M. Paul Bourget se décidera, quelque, jour, à nous livrer l'œuvre,
en même temps que la pensée qu'il détient et garde, avec une fidélité bien jalouse, et vraiment par trop silencieuse.
N'oublions pas, dans les Caresses de M.
Jean Richepin, la pièce qui commence ainsi :
O pauvre Juvigny,
pauvre Être solitaire,
Ce distique n'est que le prélude (combien
ancien déjà, et demeuré sans écho ! ) de l'hommage à rendre au penseur inconnu, à l'écrivain enlevé dans sa fleur, mais du
moins méritant de ne pas demeurer ignoré, et que peuvent révéler assez
de correspondance - à laquelle il excellait - assez de fragments, pour
que le silence, à l'égard d'une telle mémoire, doive être considéré comme
une impiété de sentiment, non moins qu'une erreur d'histoire.
Une raison de plus pour ne pas douter
de l'extrême, de l'excessive rareté de ces " souveraines amitiés ", dont
parle Montaigne, celles-là s'exerçant de cœur d'homme à cœur d'homme. " il faut tant de rencontres à la bàtir, écrit cet illustre auteur,
que c'est beaucoup si la fortune y arrive une fois en trois siècles. "
Au reste; Montagne qui s'est évidemment
inspiré de Cicéron pour écrire son Chapitre de l'Amitié, ne fait que répéter
ici le passage du de Amicitia, lequel s'exprime ainsi : " Ex
omnibus sœculis, vix tria, aut quatuor nominantur paria amicorum. " - " Dans tous les siècles passés, à peine peut-on citer trois ou quatre
paires d'amis. "
*
Un procédé auquel, en ce qui me concerne,
je me suis souvent conformé, pour l'avoir employé, non sans m'en louer,
c'est, avant de traiter un sujet, d'élire quelques-uns de ceux qui s'y
sont appliqués de façon notable, d'examiner leurs points de vue et leurs
réflexions sur le propos, d'en faire ressortir les mérites et les divergences
; puis, ayant étudié comment elles se peuvent assortir à notre personnelle
manière d'envisager la question, d'y ajouter ce qu'ont pu nous en suggérer
notre propre inspiration et notre expérience.
Point n'est besoin, pour cela, de chercher
longtemps; ni loin. Les exemples les plus fameux ont souvent l'avantage
de réduire le thème à ses éléments principaux, sur lesquels se peuvent
brocher des variations nouvelles. En outre, il ne faut pas multiplier
ces exemples, de peur de fatiguer l'attention et de l'égarer. Qu'ils soient
seulement choisis avec assez de ressemblance pour s'enchainer, avec assez
de disparité pour nous offrir des aspects différents d'une même vérité,
ou d'une même chimère.
Le discours de Cicéron, sur l'Amitié,
pourrait aussi bien s'appeler un sermon, dans la monotone, froide et solennelle
acception de ce mot, quand ne vient pas l'échauffer l'éloquence d'un Bossuet,
ou d'un Lacordaire. L'Amitié, telle que nous la présente le célèbre orateur,
ressemble à une statue de la même époque. Elle n'est pas nue ; plutôt
gaînée dans la rigide armure d'un peplum aux plis droits ; elle n'a pas
les bras ouverts ; son geste est â peine accueillant
, elle porte les cheveux disposés soigneusement en diadème vermiculé,
comme un buste d'Impératrice Romaine. Et comment ses yeux auraient-ils
des regards ? Les paupières des statues ne se lèvent-elles pas sur des
yeux, sans prunelles ?
Cependant, en sa bouche entr'ouverte,
son sculpteur a placé des mots d'airain, des paroles d'or, dont on regarde
sans fin les mots se ranger autour de son visage de bronze, ainsi qu'en
de métalliques phylactères.
Ils font ressortir, ces mots rigides que
je m'efforce d'assouplir en les traduisant - ils font ressortir, comme
le fera plus tard la phrase plus ductile du grand Essayiste, la supériorité
des liens du cœur sur les liens du sang :
" L'amitié l'emporte, en cela, sur
la parenté, que la parenté peut aller sans bienveillance; l'amitié, non.
Retranchez la bienveillance, l'amitié perd son nom; la parenté garde le
sien. La force de l'amitié, voici qui peut la faire comprendre: destinée
par la nature à l'immense famille du genre humain, elle est devenue chose
si concentrée et si restreinte, qu'à peine unit-elle deux âmes, ou peu
davantage. "
" Cette Vie vivante (Vita vitalis),
dont parle Ennius, comment la goûter hors du mutuel repos d'une bienveillance
amie ? Quoi de plus doux que de trouver à qui parler avec autant
de confiance qu'à soi-même? - Quel serait l'avantage de la prospérité,
si l'on n'avait avec qui la partager? Et, notre adversité, n'est-ce pas
en prendre la moitié que de s'en affliger plus que nous-mêmes ? "
" L'Amitié contient tout. Où que
vous soyez, elle est là. Nul lieu ne l'exclut. Elle n'importune ni ne
lasse. Aussi bien, l'eau et le feu sont-ils moims nécessaires. Notez que
je ne parle point de l'amitié ordinaire et courante, mais de cette vraie
et parfaite amitié qui ne fut le lot que d'un petit nombre. Celle-là nous
allège nos peines, à force de les comprendre et de les partager ; en même
temps qu'elle accroît pour nous le resplendissement du bonheur. "
" Le premier de ses avantages est
d'illuminer d'espoir notre avenir, et de ne permettre à notre esprit ni
la faiblesse, ni la chute. Voir son ami n'est-ce pas se contempler soi-même ?
Présence, dans l'absence; abondance, dans la misère ; force, dans la faiblesse
; mieux encore, vie, dans la mort. Le culte du souvenir et la permanence
du regret, représentent l'honneur des survivants et le bonheur des disparus. "
Ainsi s'exprime avec sagesse et non sans
grâce, cette docte amitié Cicéronienne. -A vrai
dire, comment s'étonner, à la suite de si calmes, mais si fermes propos,
de la voir se détourner, en face de certains excès (le dévouement, qui pourraient bien nous trouver moins rebelles ? Il s'agit d'un
homme à qui l'on reproche une obéissance aveugle aux volontés de son ami
: " Et s'il vous avait ordonné de mettre le feu au Capitole ? - Jamais
il n'aurait voulu cela. - Mais s'il l'avait voulu
- J'aurais obéi. " - Certes, voilà un paruissem, qui ne me semble pas inférieur, en laconisme éloquent,
disons-le, en beauté, au " qu'il mourût ! " de Corneille,
surtout après cette réserve de ne point admettre qu'un ordre criminel
puisse être donné par la bouche d'un homme révéré. Mais, cependant; s'il
faut, à tout prix, passer outre, le crime ne cessera-t-il pas de mériter
ce nom, étant accompli par une main amie ?
Permis de ne pas imiter un zèle aussi
entier; mais, ne pas l'admirer en quelque chose, paraît difficile à qui
n'est pas une forte, mais froide amitié de bronze, gaînée dans les plis
droits de sa tunique de métal, en laquelle habite un cœur qui sonne le
creux, sous les paroles apprêtées.
Nous avons emprunté au Christianisme un
de ses termes consacrés, pour qualifier du nom de Sermon, le discours
un peu pédant de cette Amicitia raisonneuse. Ajoutons qu'elle n'est pas
loin de nous sembler, enfin, légèrement pharisienne.
Aussi bien, ne l'oublions pas, l'ère dont
nous parlons n'était-elle pas à la veille de donner, de son pharisaïsme,
des exemples absolus et des preuves contagieuses
*
Combien l'Amitié de Montaigne nous apparaît
moins gourmée, plus sympathique déjà, non plus drapée à l'antique, mais
à l'ancienne ; et comme elle est déjà plus près de nous par ce rapprochement,
encore l'est-elle davantage par les battements du cœur que nous entendons
palpiter au-dessous, qui, celui-là, ne sonne pas le creux, mais rythme
harmonieusement, les pulsations, les sentiments et les pensées. Pour saine
et sainte qu'elle tienne à se montrer à nous, elle ne veut pas être tenue
pour bégueule, ni faire la renchérie. Elle sait très bien qu'il est sublime,
le mot traité par Lelius de vox nefaria (propos néfaste); et elle décide
de l'annexer aux fastes de l'Amitié, en lui trouvant une interprétation
acceptable. Ce sera celle-ci : l'homme qui l'a proféré ne court aucun
risque de se voir entrainer, par l'excès de son zèle, à la participation
d'un acte répréhensible, parce qu'il sait (et c'est juste cette certitude
qui donne la mesure de son sentiment) que l'être en lequel il a foi ne
peut rien commander de blâmable. Et l'auteur du chapitre ajoute bien :
" Il n'est pas en la puissance de tous les discours du monde de me
déloger de la certitude que j'ai des intentions et jugements de mon ami
; aucune de ses actions ne me saurait être présentée, quelque visage qu'elle
eut, que je n'en trouvasse incontinent le ressort. ".
C'est bien dit ; et, cependant, qu'est-ce
encore, auprès de l'immortelle figure d'amitié que va nous présenter
le Livre de bonne foy ? On sait qu'elle a été tracée par Michel de Montaigne
d'après son ami Étienne de la Boétie. " Cette amitié que nous avons
nourrie, tant que Dieu a voulu, entre nous si entière et si parfaite,
que certainement il ne s'en lit guère de pareilles..... amitié de notre choix et liberté volontaire. Et notre liberté volontaire n'a
point de production qui soit plus proprement sienne, que celle de l'affection
et de l'amitié. "
Au cours de mes relectures du chapitre élu, j'ai fait choix des plus émouvants d'entre les passages qui le composent,
et je les rapproche dans un ensemble qui, en faisant mieux ressortir le
sentiment, en compose, en concentre l'hommage renouvelé, et pour ainsi
dire, remontant à la mémoire de qui l'inspira :
" Si on me presse de dire pourquoi
je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer, qu'en répondant : parce
que c'était lui, parce que c'était moi. Il y a au-delà de tout mon discours,
et de ce que j'en puis dire particulièrenient, je ne sais quelle force
inexplicable et fatale, médiatrice de cette union. Nous nous cherchions,
avant que de nous être vus, par des rapports que nous oyons l'un de l'autre,
qui faisaient en notre affection plus d'effort que ne porte la raison
des rapports ; je crois par quelque ordonnance du Ciel. Nous nous embrassions
par nos noms. Et, à notre première rencontre, qui fut par hasard en une
grande fête et compagnie de ville; nous nous trouvâmes si pris, si connus,
si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche que de
l'un à l'autre.
" Il écrivit une satire latine excellente,
qui est publiée, par laquelle il excuse et explique la précipitation de
notre intelligence, si promptement parvenue à la perfection. Ayant si
peu à durer, et ayant si tard commencé - car nous étions tous deux hommes
faits, et lui plus de quelques années - elle n'avait point à perdre de
temps, et n'avait à se régler au patron des amitiés molles et régulières,
auxquelles il faut tant de précautions, de longue et préalable conversation.
Celle-ci n'a point d'autre idée que d'ellemême et ne se peut rapporter
qu'à soi. Ce n'est pas une spéciale considération, ni deux, ni trois,
ni quatre, ni mille; c'est je ne sais quelle quintescence de tout ce
mélange, qui, ayant saisi toute ma volonté, l'emmena se plonger et se
perdre en la sienne qui, ayant saisi toute sa volonté, l'emmena se plonger
et se perdre en la mienne, d'une faim, d'une concurrence pareille. je dis perdre, à la verité, ne nous réservant rien qui nous fût propre, ni
qui fût ou sien ou mien. "
" Nos âmes ont charrié si unanimement
ensemble, elles se sont considérées d'une si ardente affection, et, de
pareille affection, découvertes jusqu'au fin fond l'une de l'autre, que
non seulement je connaissais la sienne comme la mienne, mais je me fusse
certainement plus volontiers fié à lui qu'à moi. "
" L'union de tels amis étant véritablement
parfaite, elle leur fait perdre le sentiment de tels devoirs, et haïr
et chasser d'entre eux, ces mots de division et de différence, bienfait,
obligation, reconnaissance, prière, remerciemeut, et leurs pareils. Tout
étant, par effet, commun entre eux, volontés, pensements, jugements, biens,
femmes, enfants, honneur et vie; et leur convenance n'étant qu'une âme
en deux corps, selon la propre définition d'Aristote, ils ne se peuvent
ni prêter, ni donner rien. "
" Si en l'amitié de quoi je parle,
-l'un pouvait donner à l'autre, ce serait celui qui recevrait le bienfait
qui obligerait son compagnon. Car, cherchant l'un et l'autre plus que
toute autre chose, de s'entre bien faire, celui qui en prête la matière
et l'occasion est celui-là qui fait le libéral, donnant ce contentement
à son ami d'effectuer à son égard ce qu'il désire le plus. "
" Car cette parfaite amitié de quoi je
parle est indivisible ; chacun se donne si entier à son ami qu'il ne lui
reste rien à départir ailleurs ; au contraire, il est marri qu'il ne
soit double, triple ou quadruple, et qu'il n'ait plusieurs âmes et plusieurs
volontés pour les conférer toutes à ce sujet. - Cette amitié qui possède
l'âme et la régente en toute souveraineté, il est impossible qu'elle soit
double. -Rien n'est extrême qui a son pareil. "
" Car on trouve facilement des hommes
propres à une superficielle accointance ; mais en celle-ci en laquelle
on négocie du fin fond de son courage qui ne fait rien de reste, il est
besoin que tous les ressorts soient nets et sûrs, parfaitement."
" Je souhaiterais aussi parler à des gens
qui eussent essayé ce que je dis ; mais sachant combien c'est chose éloignée
du commun usage qu'une telle amitié, et combien elle est rare, je ne m'attends
pas d'en trouver aucun bon juge. Car les discours mêmes que l'antiquité
nous a laissés sur le sujet, me semblent lâches, au pris du sentiment
que j'en ai. Et, en ce point, les effets surpassent les préceptes mêmes
de la philosophie.
" L'ancien Ménandre disait celui-là heureux
qui avait pu rencontrer seulement l'ombre d'un ami. - Car, à la vérité,
si je compare tout le reste de ma vie - si je la compare toute aux quatre
années qu'il m'a été donné de jouir de la compagnie
et société de ce personnage, ce n'est que fumée, ce n'est qu'une nuit
obscure et ennuyeuse.
" Depuis le jour que je le perdis; je
ne fais que trainer languissant ; et les plaisirs mêmes qui s'offrent
à moi, au lieu de me consoler, me redoublent le regret de sa perte. Nous
étions à moitié de tout : il me semble que je lui dérobe sa part. "
Qu'ajouter à un pareil portrait? Dieu
me garde de la sotte puérilité de penser embellir Montaigne !
Cependant, je le répète, je me flatte
d'avoir concrété, en en rassemblant les disjecta membra, la magnifique
Nénie qui, à partir de cette "ordonnance du ciel", précipitant ses amis
dans cette affection, jusqu'à cet émouvant trait final, donne pour jamais
à se reconnaître dans ces pages (j'entends : pour le sentiment) au petit
nombre de ceux qui goûtèrent pareil attachement - hélas! En attendant
d'avoir à le pleurer.
Pas un mot à relever, dans cette description,
sous peine d'avoir à paraphraser chacun d'eux comme il le mériterait,
mais non sans crainte de prolonger outre mesure un ouvrage qu'il faut
limiter.
Qu'il me soit seulement permis de fixer,
une minute, l'attention sur les saisissantes expressions de " cette précipitation
de notre intelligence ", - de ces "âmes qui ont charrié si unanimement
ensemble " ; - sur le mépris à faire, pour de tels cours, " des mots
d'obligation, et autres pareils " ; et sur cette générosité dont fait,
seul, preuve, celui qui permet qu'on l'oblige. - Et la noble fierté, d'avance
dédaigneuse, du faux jugement qui peut être fait d'un sentiment si supérieur
et si rare.
Quelle différence d'attendrissement entre
l'impassible Amitié Romaine, et cette vivante, cette vibrante Amitié du
xve siècle; cette Amitié Française, et humaine !
Mais à un homme de nos jours, pour mirer
humblement, fièrement aussi, la part d'un sentiment si exceptionnel qui
lui pût être faite, à son tour, par une providentielle ordonnance, il
faut que ce sentimental miroir des Ages, dans la sévère bordure de Cicéron,
ajoute quelque chose encore, à la glace de Montaigne. Ce quelque chose,
ce doit être un tain de pensées, et de sensations, plus modernes et plus
troublées. - Et, s'il s'y joint quelque chose de valétudinaire, de morbide,
qui fasse trembler les reflets, nos larmes pourront s'y reconnaître, à
nous qui avons versé les mêmes pleurs sur le cœur du cristal sensible.
Cette mobilité presque liquide, de la
plus douloureuse des psychés, c'est Goncourt qui me la présente dans les
pages que le Journal consacre à la mort de son frère.
Musset a écrit: " Nul ne se connait tant
qu'il n'a pas souffert. " - Pensée qu'on pourrait varier ainsi : " Apaise
sa souffrance, qui se reconnaît dans une parité de désespérance. "
Je sais de faibles Chrétiens qui s'irritent
et se découragent à la lecture de L'Imitation, laquelle parait inimitable
à leurs débiles efforts, à leur perfection imparfaite. Une parcelle du
nard d'épi échappée à l'albâtre de Madeleine, leur vaudra mieux, pour
leur purification, que toute l'hysope d'A'Kempis.
Pareillement, de quelle consolation peut être, pour notre endolorissement actuel, la fraternité de Prométhée enchaîné ou de L'Ugolin Dantesque?
Combien me touche davantage le calvaire
vécu, de ces deux frères aristocratiques, ces deux intellectuels hyperesthésiés,
admirés dans leur vol jumeau et frissonnant par les aigles les plus hardis
du Ciel Romantique; lorsque l'un d'eux, blessé à mort, par une trop ardente
tension vers son foyer d'art, retombe comme un Icare juvénile, pleurant
et foudroyé, de toute la hauteur d'une ambition double !
Donc, je le répète, au grave cadre de
Cicéron, à la subtile et sensible glace de Montaigne, ajoutons le tain
douloureux des Goncourt, auquel nous ne joindrons plus qu'un autre reflet,
avant d'y mirer nous-même l'image de notre attachement pour Celui qui
nous inspire cet ouvrage.
*
Remontons, avec Edmond de Goncourt, le
calvaire gravi par lui, à la veille de 70, et dont il a marqué les stations
dans son Journal d'alors, quelques-unes plus appuyées, d'autres simplement
fixées d'un trait, mais saignant et poignant.
Certes, ces stations, elles ne sont pas
exemptes de Goncourisme, à savoir de cette hypertrophie du moi qui devait
devenir la caractéristique de ce survivant. Seulement, cette caractéristique,
pour sévèrement qu'elle ait été jugée, n'a peut-être pas été observée,
avec clairvoyance, avec bonne foi. Car, alors, d'un peu agaçante qu'elle
apparaît, vous la jugeriez plutôt émouvante, si l'excès de sa revendication
se reporte sur une mémoire, et retourne vers un
tombeau.
Telle est mon interprétation d'un égoïsme,
qu'on n'a jugé risible que pour n'avoir pas su le voir larmoyant, et qui
n'était pas même un égoïsme à deux. Ce fut un égoïsme pour un autre. Ainsi
envisagé, il devient touchant. Certes, on peut le supposer; ce Goncourt,
non dépareillé, aurait eu une tout autre vieillesse. Les hommages qui
lui venaient sur le tard, les partager avec qui de droit les lui aurait
rendus sensibles. De là qu'ils lui semblaient, au contraire, offensants,
manquant d'exactitude, de sembler plutôt ironiques â l'égard de Celui
qui mourut de les attendre.
Aucun des contemporains n'est plus guère
d'âge à nous représenter l'Edmond d'hier, à nous dire, que, comme je le
crois, il ne contenait pas en germe le bougon que nous avons connu et
qui ne parut amer que pour avoir été douloureux.
Mais les témooignages antérieurs sont
d'accord avec cette explication qui fait, précisément, de ce titre de
survivant, le motif et le mot d'un homme-énigme, mal compris de ceux qui
l'ont connu tard. Il est probable que toute sa sensibilité s'est dissoute
en ce jour, amara valde, que Gautier nous a décrit, et, pour faire
place à une incurable et monotone sécheresse, trop hautaine pour daigner
s'expliquer, trop irrévocable pour ne pas dédaigner de s'en plaindre.
Écoutez plutôt l'Auteur des Portraits
Contemporains ; il nous parle d'une " individualité double ",
de " deux âmes charmantes, réunies en une seule perle comme deux
gouttes d'eau fondues ensemble ", - ou, plutôt d'une âme unique
habitant deux corps ". - " C'était une seule personne en deux volumes ".
Aussi, le jour venu de la séparation brutale,
quel " navrant spectacle !... "
" Edmond, dans sa stupeur tragique,
avait l'air d'un spectre pétrifié; et la mort qui ordinairement met un
masque de beauté sereine sur les visages qu'elle touche n'avait pu effacer
des traits de Jules une expression d'amer chagrin et de regret inconsolable.
Il semblait avoir senti, à la minute suprême, qu'il n'avait pas le droit
de s'en aller comme un autre, et
qu'en mourant il commettait presque un fratricide. Le mort, dans son cercueil,
pleurait le vivant, le plus à plaindre des deux, à coup sûr. "
Edmond, " aveuglé de larmes, et soutenu
sous les bras par ses amis, buttait à chaque pas comme s'il eut eu les
pieds embarrassés dans un pli trainant du linceul fraternel ". Sa
figure "semblait reflétée par une lueur de l'autre monde et avait l'air,
sous le soleil ardent, d'un clair de lune en plein jour ".
Une telle description ne plaide-t-elle
pas en faveur de l'explication que je donnais, plus haut, du Goncourisme
que nous avons connu ? La manifestation, dans les pages du Journal consacrées
à la mort de Jules, nous semblera toujours un peu puérilement infatuée
et vaniteusement fidèle à elle-même, quand elle voudra faire de cette
mort, la mort-type " d'un mourant de la littérature et de l'injustice
de la critique ". Mais quand ce même Journal nous exprimera le " désir
vague d'en fixer le déchirant pour des amis futurs de la mémoire du bien-aimé... "
combien le Goncourisme nous semblera mieux inspiré et nous attendrira davantage!
Mais là s'arrête le postulatum de celle
sensibilité farouche. Si donc elle atteint plus haut, et plus loin, (et
elle y atteint) c'est sans y songer et même sans s'en apercevoir.
Oui, ce supérieur résultat qui est de
nous consoler, ou du moins d'adoucir nos peines, en présentant à nos deuils
personnels cette image d'un " jeune homme vêtu de noir, qui leur
ressemble comme un frère ", elle le réalise sans y prendre garde.
Et, cela, certes, (dont elle soit bénie!)
je le proclame, elle le réalise, pour moi, comme, je le crois bien, ne
réalisera jamais aucun verbe humain, quand elle s'écrie: " Devant
le cadavre de Celui qui m'aima tant, de Celui pour lequel il n'y avait
de bien et de bon que ce qui avait été fait ou dit par (ici chacun des
désespérés place son propre prénom) je souffre, je souffre, je crois,
comme il n'a été donné à aucun être aimant de souffrir! "
Il a raison et il se trompe. II est seulement à égalité avec tous les êtres aimants dignes de ce nom.
Laissons-le continuer de parler pour eux :
" Oh ! il y aura des gens qui diront que je n'ai pas aimé mon frère. Cette affirmation
ne me touche guère, parce que j'ai la conscience de l'avoir plus aimé qu'aucun de ceux qui diront cela, n'ont aimé
une créature humaine. "
"Dire que cette liaison intime et inséparable
de vingt-deux ans, dire que ces jours passés ensemble... oui, dire que
c'est fini, fini à tout jamais. Je ne l'aurai plus marchant à côté de
moi, quand je me promènerai. Je ne l'aurai plus en face de moi quand je
mangerai. Je n'aurai plus, avec mes yeux, ses
yeux, pour voir les
pays, les tableaux, la vie moderne. Je n'aurai plus son intelligence jumelle
pour dire avant moi ce que j'allais dire, ou pour répéter ce que j'étais
en train de dire. Dans quelques jours, dans quelques heures, va entrer
dans ma vie, si remplie de cette affection, et qui, je puis le dire, était
mon seul et unique bonheur, va entrer l'épouvantable solitude du vieil
homme sur la terre ! "
Et ce dernier trait, peut-être le plus
simple, et, pour cela, le plus humain, le plus pantelant :
" Quand je vois, en face de moi,
de l'autre côté de la table à manger, ce fauteuil qui restera éternellement
vide, mes larmes tombent dans mon assiette, et je ne puis manger. "
*
Avant de parler plus expressément de la
mienne, dont ce fut, au reste, m'occuper que de rechercher au fond du
cristal endormi, mais toujours murmurant, de ces immortels miroirs, le
visage de ces amitiés mortes, je veux encore citer une autre affection
entre deux littérateurs, Flaubert et Bouillhet : " J'ai rarement
vu, écrit M. Félix Duquesnel, amitié plus, grande, et plus touchante que
celle qui unissait ces deux hommes; le lien était si étroit, si absolu
qu'on ne concevait guère l'un sans l'autre. " - Aussi, quand se prépare
une première de Bouillhet, Flaubert est follement ému, nerveux" agité,
pris de fièvre. Son ami meurt. Flaubert le remplace; veut le triomphe
pour cette ombre chère, et demeure inconsolable si le public refuse ses
applaudissements à l'œuvre de Celui qui n'est plus.
Mais il y a plus beau.
Certaine tirade ayant paru supérieure
au reste de l'œuvre, on accuse le survivant de l'avoir ajoutée, de son
chef, à l'ouvrage du défunt. Alors, Flaubert s'emporte, s'affole, perd
tout repos jusqu'à complète démonstration de l'erreur du public. Et,
quand il a fait rendre à son ami l'hommage mérité, il s'écrie: " A présent,
je vais pouvoir dormir l Je ne dormais plus depuis qu'on avait pu me croire
coupable d'un manque de respect à la mémoire de mon pauvre Louis ! "
Bel exemple, et que je me vante, que je
me flatte d'imiter, dans la mesure des moyens de mon esprit et de mon
cœur.
Certes, moi non plus, je ne dormirai pas,
avant d'avoir accompli cet ouvrage; je ne dormirai plus tant qu'on pourra
me croire capable d'un manque de fidélité à l'égard de mon pauvre Gabriel !
*
Si, comme j'ai tout lieu de le croire;
ma mémoire, sur ce point, me sert avec précision, je suis entré en communication
avec Gabriel de Yturri, le lundi 16 mars 1885. C'était à l'Exposition
des œuvres de Delacroix qui se tenait à l'École des Beaux-Arts. Sur sa
demande, un des représentants du Tout-Paris d'alors, un ami commun (disons
plutôt une connaissance) nous mit en relations. Ce jeune Argentin, assez
frais débarqué dans la grand'ville, y avait entendu parler de moi, d'une
façon qui l'avait séduit. Il sut me l'exprimer, séance tenante, avec une
vivacité et une apparente sincérité qui me séduisirent à mon tour. A ceux-là
seuls qui, tant de fois, se sont justement émerveillés depuis, - même
quand le temps et le mal en avaient assourdi les brillants et charmants
éclats, - devant sa faconde extraordinaire et, disons-le, véritablement
inouïe, il peut être donné aujourd'hui de se faire une idée de ce que
put être, ce jour-là, le torrent de son amabilité merveilleuse. Tout
ce que je puis, veux et dois dire, c'est qu'elle a, elle aussi, " charrié ",
vingt ans d'incomparable amitié, de zèle brûlant et permanent, de dévouement
clairvoyant et hardi, d'inaltérable et constante fidélité, et ne s'est
épuisée que dans la Mort. Encore y aurait-il, de ma part, une invraisemblance
et une injustice à admettre, même à supposer qu'un semblable foyer de
zèle ait pu expirer et s'éteindre. Je ne sache pas d'âme dont la fréquentation
ait su léguer invinciblement, à ceux qui en out subi l'effluve généreux
et chaleureux, une telle conviction de l'inextinguible. El c'est encore,
pour moi, entre mille, une reconnaissance de plus à lui devoir.
Est-il accordé à cette survie de brûler
encore pour les chers intérêts qui l'ont passionnée en ce monde?
Quand le moment sera venu de rapporter
les émouvantes paroles proférées par lui, devant la mort, je dirai celle
qui laisse voir (avec quelle poignante beauté!) que cette incertitude
fut son dernier supplice, en même temps que le sublime dernier mot de
son affection envers moi. La réponse à ce doute est dans le secret de
l'Au-delà. Mais où qu'ait émigré cette âme, elle continue, sans nul doute,
à s'acquitter de ce qui fut le triple fonctionnement de cette admirable
entité : palpiter, vibrer et brûler.
Dès cette première minute de notre rencontre,
le miracle de sentiment décrit par Montaigne, venait non seulement d'éclore
entre nous, mais de réaliser une perfection dont vingt ans de bons offices
ont pu varier les effets, sans pouvoir augmenter un attachement qui, de
son élan initial, avait atteint les plus hautes cimes affectives. Pour
ceux qui voudront en mesurer l'étendue, il suffira de se reporter aux
extraits que j'ai cités de cet auteur, comme je le fais moi-même, quand
je veux rechercher dans la surface la plus polie qu'aient étamée pour
nous, l'art et la cordialité, le visage de mon souvenir.
Du reste, c'est ainsi qu'il me faut procéder,
d'une si impérieuse nécessité qu'elle en devient irréfragable, et la condition
sine qua non de la création de ce cher Livre. Non que je veuille en exclure
telle ou telle vicissitude d'un passé tout de
beauté et de ferveur. Mais, précisément, parce que le rapport qui pourrait
exister entre la multiplicité du sujet; et ma glose, menacerait cette
dernière de se montrer intarissable, en même temps que de tourner au
dithyrambe.
On comprendra donc que je veuille, qu'il
me faille restreindre mon commentaire personnel de la vie d'un tel compagnon
de mon existence et de ma pensée. Il me serait trop facile d'en parler,
trop difficile de m'en taire. Ces pages risqueraient d'errer, de se perdre,
de ne plus finir. Pour cela, je veux me borner, et les restreindre. Aussi
bien, est-il plus sage, en même temps qu'il m'est plus doux, de laisser
aux documents et aux évènements, le soin de s'exprimer sur un propos qui
m'est si infiniment précieux! Et c'est ma consolation de n'en voir aucun
qui soit capable de laisser parler de soi, par les personnes et par les
choses, avec une si captivante fécondité, une si éloquente apologie.
Ce n'en est pas moins, je le sais, un Livre spécieux à effectuer, puisqu'il doit être écrit impétueusement, en même temps qu'avec mesure. Mais la difficulté n'est-elle pas, en art, comme en hydraulique, un stimulant â s'élever vers le Ciel ?

