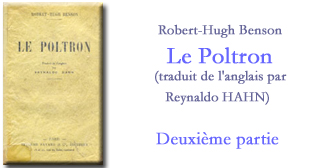 |
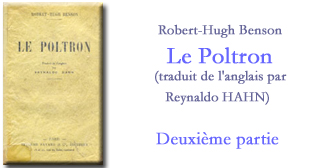 |
CHAPITRE IX
I
II faisait presque noir dans le wagon-lit à deux couchettes. Le train de luxe Rome-Paris filait à travers les plaines méridionales de la France, et l'aube, traversant les stores baissés qui claquaient au vent, se mêlait à la lumière voilée de l'ampoule fixée au plafond.
Val, étendu sur la couchette du haut, se retourna et appuya sa joue au rebord, pour regarder son frère. Il avait renoncé depuis longtemps à s'endormir. Les yeux mi-clos, il écoutait les coups rythmés du train qui ponctuaient le grondement ininterrompu des roues, le frémissement des stores agités, les battements d'une porte laissée ouverte dans le couloir; il écoutait et réfléchissait.
Enfin, il ouvrit les yeux et se mit à étudier machinalement les objets qui emplissaient le réduit : les vêtements d'Austin, posés en tas sur un petit siège canné; par terre, quelques journaux italiens; son propre manteau de voyage et son chapeau se balançant à une patère près de la fenêtre ; une boîte de cigarettes qu'Austin l'avait chargé de cacher avant qu'on arrivât à Modane et qui, ensuite, avait reparu ; et, enfin, le bord du couvre-lit rouge de la couchette inférieure où dormait Austin.
Il se pencha davantage, pour voir si le bras de son frère, presque guéri maintenant, reposait bien dans son écharpe, ainsi que l'avait prescrit le médecin. Puis il se recoucha et resta tranquille.
Dix minutes après il se redressa, se mit à genoux, fouilla dans la poche de son veston pendu au pied de la couchette et y prit un portefeuille en cuir. Il en tira un papier plié et se recoucha pour le lire, aussi bien que le permettait la faible lumière. C'était bien la cinquantième fois qu'il relisait ces lignes d'une écriture énergique, bien qu'un peu jeune encore et scolaire.
" J'ai repensé à tout ce que vous m'avez dit ; et ma réponse reste la même ; rien de ce que vous pouvez dire ou faire ne
" Gertie Marjoribanks. " II lut cette lettre, lentement, avec toutes ses phrases cruelles, ses velléités mélodramatiques, ses sentiments pesés, raisonnables, mi-enfantins mi-féminins - et bien qu'il la sût par cœur. C'était la dernière communication reçue de Gertie au sujet de l'affaire. Ils avaient eu d'abord deux ou trois conversations, puis, huit jours après le duel et trois jours avant que le docteur permît à Austin de partir, il avait trouvé cette lettre sur sa table. Il n'y avait pas répondu.
Un seul mot peut résumer son état d'âme :
II
- Val, es-tu réveillé ? Il se pencha aussitôt.
- Oui. As-tu besoin de quelque chose ?
- Je voudrais que tu viennes voir ce cordon ; il y a un noud qui me gêne.
Val passa ses jambes par-dessus le rebord et sauta. Austin tressaillit.
- Je t'en prie, ne saute pas comme ça! dit-il. Je te l'ai déjà demandé hier soir. Ça me fait contracter le bras.
- Oh ! pardon. Voyons ce qui te gène.
- Doucement, dit ensuite Austin ; tu m'as touché le poignet.
- Je te demande pardon. Est-ce mieux comme ça ? Tu n'as pas besoin d'autre chose ?
- Quelle heure est-il ? Probablement trop tôt pour demander du café.
- Je vais aller voir. Il doit être six heures. Dix minutes après, il revint avec un plateau.
- Comme tu as été long ! dit Austin.
- J'en ai porté un peu aussi à Gertie et à May. Austin ne répondit rien. Val emplit une tasse et lui tint la soucoupe pendant qu'il buvait.
- Ça va mieux, dit Austin, plus aimablement, en s'appuyant contre l'oreiller. Et maintenant, si tu veux me donner une cigarette...
Val la lui donna, puis, ayant bu à son tour une tasse de café, posa le plateau par terre dans le couloir et se disposa à regrimper dans son lit.
- Tu veux dormir encore ? demanda Austin.
- Je n'y tiens pas. Pourquoi ?
- Nous pourrions causer un peu. Gertie et May vont bientôt se lever et nous ne trouverons peut-être plus l'occasion de le faire.
- Très bien. Attends une seconde ; je passe un veston.
Alors, Austin s'installa comme pour faire une conférence.
Il faut bien l'avouer, Austin n'était pas mortifié outre mesure du tour qu'avaient pris les choses. Certes, il avait beaucoup souffert ; sa blessure avait été très douloureuse pendant les premiers jours et même maintenant, quand Val, en le soignant, commettait une maladresse, elle lui faisait encore mal. De plus, il était sincèrement affecté par le coup infligé à l'honneur de la famille ; il n'en revenait pas de la conduite de son frère. Néanmoins, il y avait des consolations : le plaisir d'être traité en héros et adoré comme un dieu par Gertie et par May - surtout par Gertie ; - la pensée que ses parents professeraient désormais à son égard une considération d'ordre tout nouveau. Le seul fait de s'être battu en duel n'allait pas sans quelque distinction, et enfin, surtout, peut-être, quoique plus subconsciemment, n'était-il pas agréable pour lui de se dire que ses rapports avec Val se trouvaient indiscutablement réglés, et pour toujours ? Il ne pouvait plus y avoir de doute quant à la question de savoir lequel devait obéir à l'autre. Il avait agi, lui, comme le modèle des frères aînés ; Val témoignait, d'ailleurs, par ses attentions et son humilité, qu'il se reconnaissait les devoirs d'un cadet.
Fort de tout cela, Austin s'installa confortablement pour faire à Val sa première conférence.
- Ecoute, dit-il, tu ne m'en voudras pas de te dire avant tout... que je trouve que tu t'occupes de Gertie et de May un peu plus qu'elles ne le voudraient. May me l'a laissé entendre hier, pendant que tu n'étais pas là. Tu ne m'en veux pas ?
- Non, je t'en prie, dis-moi tout.
- Eh bien, tu comprends, elles sont terriblement bouleversées toutes les deux en ce moment... Et tu as un peu l'air de... de vouloir les amadouer... Laisse un peu aller les choses et ça s'arrangera. Du moins...
Val ne dit rien.
- Tu permets que je te parle franchement ?
- Oui, je t'en remercie.
- Par exemple, cette idée d'aller leur porter du café !... Elles aimeraient bien mieux sonner et en demander. Sincèrement, je crois que tu feras bien de te tenir plutôt... un peu à l'écart.
Val acquiesça de la tête.
- Mais, continua Austin, ce dont je tenais surtout à te parler, c'est de ce qui va se passer quand nous serons rentrés à la maison, de ce que nous allons leur dire, etc...
- Je devrais déjà être à Cambridge ; les cours ont recommencé il y a huit jours. Je pensais que...
- Oh ! mais il ne faut pas esquiver la rentrée à
- Je ne voulais pas dire que je ne rentrerais pas à la maison, dit Val humblement, mais que ce ne serait que pour un jour ou deux.
- Eh bien ! interrompit Austin avec quelque brusquerie, qu'est-ce que ça fait ? Ce qui devra être dit le sera tout de suite. Tu n'espères pas qu'ils vont faire comme s'il ne s'était rien passé ?
- Non, certainement.
- Eh bien ! la question est cell-ci : quelle conduite allons-nous adopter ? Dieu sait que je ne cherche pas à faire des embarras ! Il s'agit de savoir s'il y a un moyen, quelconque de présenter les choses sous un jour acceptable.
- Je me propose de leur dire la vérité.
- Mon Dieu, mon Dieu, Val ! on dirait que tu ne peux penser absolument qu'à toi, même dans le cas présent. Tu ne comprends donc pas que pour papa c'est le coup le plus affreux qu'il ait jamais reçu ? Ce n'est pas à toi que je pensais, mon cher, c'est à lui. Il s'agit de savoir s'il y a moyen de dire quelque chose qui rende le choc moins dur, que tu étais vraiment malade, par exemple ? Tu n'as pas du tout l'air de te rendre compte que l'honneur et le courage sont... Qu'est-ce que tu as ? - Rien, continue.
Austin le regarda, un peu gêné. Val avait fait un mouvement en arrière comme si on lui eût donné un coup en pleine figure ; et, dans la demi-obscurité - car la lumière était toujours voilée - il paraissait singulièrement pâle.
Austin se promit d'être moins dogmatique, mais il fallait tout de même parler clairement.
- Ecoute-moi, Val, je sais que tout ça n'est pas agréable pour toi. Mais il faut affronter les événements. Tu connais les idées de papa. Tu te rappelles le laïus qu'il nous a tenu quand nous sommes entrés au collège sur " l'amour-propre, la dignité, etc.. " Eh bien ! pour lui, autant que pour maman, nous devons tâcher d'atténuer l'affaire autant que nous le pourrons. Et je crois que la version de ton malaise serait la meilleure à adopter.
- Je crains que ce ne soit plus possible maintenant, dit Val presque sans voix.
- Comment ? Je n'entends pas.
- Je crains qu'il soit trop tard. Rappelle-toi que May et Gertie sont au courant.
- Je le sais bien. Tu as absolument tenu à tout leur raconter. Je t'avais prié de n'en rien faire.
- Enfin, maintenant, c'est fait.
Austin réfléchit, puis :
- Alors, qu'est-ce que tu proposes, demandât-il ?
Val se leva, cherchant dans sa poche son porte-çigarettes (peur détendre un peu la situation, pensa Austin) et, mettant une cigarette entre ses lèvres, il répondit :
- Je n'ai rien à proposer, si ce n'est l'entière vérité. Je propose de la dire, sans y rien changer, et... et d'affronter les événements, comme tu dis. Il n'y a rien à faire, Austin : il faudra finir par tout dire à papa. Naturellement, je veux bien que quelqu'un s'en charge - si quelqu'un est disposé à s'en charger. Je... je ne tiens pas particulièrement à le faire moi-même. D'ailleurs, il doit déjà savoir l'essentiel, je suppose...
- Il sait que tu... que tu as refusé de te battre au dernier moment et qu'il a fallu naturellement que je te remplace.
- Eh bien, c'est exact, n'est-ce pas ?
Austin savait bien, au fond, que c'était inévitable, que la vérité ne pouvait être tenue secrète. Mais il reculait devant cette certitude.
- Ecoute, dit-il, je te prends au mot. May et moi nous lui dirons... Nous ferons pour le mieux. Mais je crois qu'il faut t'attendre à... enfin... à des observations.
- Je m'y attends. Il y eut un silence.
- Autre chose encore, reprit Austin. C'est à propos de Gertie. Tu te souviens que nous nous sommes disputés un jour à ce sujet. Eh bien ! écoute, est-ce que tu as... est-ce que tu as un engagement quelconque avec elle ? un engagement secret ? De deux choses l'une...
- Tu veux parler de fiançailles ?
-. Oui ; enfin de fiançailles sous-entendues, même sans promesses formelles.
- Il n'y a rien, dit Val. Il n'y a pas entre nous la moindre entente.
- Alors, ça va bien. Parce que j'allais te dire que cela valait mieux - du moins pour le moment. Quand on est dans une passe difficile, on ne doit pas... Qu'est-ce qu'il y a ?
- Je me suis brûlé la lèvre, dit Val.
__ Eh bien, voilà ; c'est tout... Val ?
Oui.
- Je sens que tu es bien embêté de tout ça et...
Il n'acheva pas la phrase : Val était parti, laissant la porte ouverte.
Austin grogna entre ses dents :
- Quel drôle de type !
III
II faisait déjà nuit quand le bateau de Folkestone aborda près de la gare pour laisser débarquer les Medd. C'était là un privilège de Medhurst, - consacré par l'usage plutôt qu'officiellement stipulé, - car la ligne de chemin de fer passait à deux ou trois milles d'une langue de terrain faisant partie du domaine. On n'en profitait pas souvent ; mais on avait remis à Austin, sur le quai de Folkestone, un télégramme lui annonçant qu'il en serait ainsi.
Une voiture fermée à lanternes flamboyantes les attendait, attelée de deux chevaux qui piaffaient, comme impatients d'entreprendre la course de douze milles qu'ils avaient à faire pour regagner Medhurst. Derrière la voiture, une charrette était prête à recevoir les malles.
Val s'attarda près de la portière du wagon, feignant de surveiller le transport des petits bagages, mais en réalité peu désireux d'apercevoir fût-ce un seul visage familier.
Quand il arriva au haut de l'escalier, les jeunes filles étaient déjà en bas et Austin descendait avec précaution, appuyé sur le bras de Simpson, valet de chambre particulier de son père, dont la présence constituait une très grande marque de faveur. En toute autre circonstance, on eût envoyé à la rencontre des jeunes gens un simple valet de pied.
Trois minutes plus tard, Austin était installé à sa place, calé par des coussins, avec Gertie à côté de lui et May en face. Val monta à son tour ; Simpson, ayant fermé la portière, monta sur le siège et la voiture partit.
Pour Val, la journée avait passé comme un cauchemar lugubre. Ils avaient déjeuné au wagon-restaurant avant d'arriver à Paris s'étaient hâtés de prendre le train à la gare du Nord. La pluie et le vent avaient rendu assez désagréable
Un silence de mort régnait maintenant dans
Austin, pour dire quelque chose, avait parlé de la pluie, du changement de temps et May lui avait répondu avec une prolixité réellement excessive, à laquelle avait succédé un nouveau silence.
- Val.
- Oui ?
- Sais-tu si on a mis dans la charrette mon petit sac jaune ?
- Oui. Du moins, je l'ai recommandé au porteur.
- Merci.
Puis, de nouveau, un long silence, rompu seulement par la pluie battant contre les vitres et le trot égal des chevaux sur la route boueuse.
Trois ou quatre phrases encore furent prononcées durant ce trajet de douze milles. May, se penchant vers Austin, lui demanda si son bras ne le faisait pas souffrir ; Gertie, répondant à une question de May, dit qu'elle serait obligée de rentrer chez ses parents dans deux jours au plus tard. Austin demanda tout haut s'il y avait du monde à Medhurst ; May dit qu'elle ne croyait pas. Et ce fut tout. L'intensité du silence s'aggravait de minute en minute ; ils ne parlaient que lorsqu'elle devenait insupportable ; ils finirent enfin par y renoncer, et tous quatre restèrent absorbés dans l'obscurité silencieuse, réfléchissant, puis prêtant l'oreille au bruit de la pluie, puis de nouveau réfléchissant.
La voiture s'arrêta devant la grille du parc ; et ce fut peut-être à ce moment que l'angoisse de Val atteignit son comble. Car il s'était toujours rappelé cet arrêt - le brusque silence des sabots et des roues, le faible cri d'un harnais ou le cliquetis d'une chaînette causés par les mouvements de tête des chevaux, - les pas sur le gravier, le bruit que faisait la serrure de la grille ; et tout cela lui rappelait, maintenant, ses retours de l'école, alors que cette pause semblait intolérable à son impatience de revoir les siens. Tandis qu'à présent !...
Il y avait un kilomètre de la grille au château. Après avoir suivi une allée de rhododendrons, ou passait devant l'étang des cygnes, puis on montait doucement à travers des bois jusqu'au gazon où des lapins venaient brouter par les soirs d'été, et enfin, après avoir gravi la colline, on descendait tout droit vers le grand château qui rêvait au milieu de ses arbres.
Personne ne parlait. Mais, comme la voiture atteignait le haut de la côte, Gertie se pencha soudain pour tâcher d'apercevoir les lumières du château ; la vive clarté des lanternes tomba en plein sur son visage, et Val remarqua une expression de fatigue dans ses beaux yeux et sur sa bouche aux coins tombants. Elle se rejeta aussitôt dans l'ombre, en lui lançant un regard. Leurs yeux se rencontrèrent.
La voiture longea sans s'arrêter la façade du château, comme c'était la coutume par les soirs pluvieux. Val vit passer sous la clarté de la lanterne la grande terrasse grise. Mais ce fut seulement quand les roues s'arrêtèrent devant le porche sud qu'il se souvint que c'était là, sous ce porche, que Gertie et lui s'étaient embrassés, le soir du bal.
Hélas ! ce souvenir était moins douloureux que le présent ; il servait simplement de " fond " ironique à sa rencontre imminente avec son père et sa mère ; son cœur lui martelait la poitrine ; il n'osait pas avancer la tête jusqu'à l'angle lumineux projeté par la porte grande ouverte.
La portière de la voiture s'ouvrit également ; il le perçut sans lever les yeux. Par bonheur, il était assis du côté opposé à cette portière. Il entendit des voix qui parlaient ; puis, la voiture grinça : Auslin, en descendant, pesait sur le marchepied.
- Doucement, Simpson, dit la voix de son père, péremptoire et anxieuse.
Il y eut un silence. May descendit à son tour ; il entendit sa mère qui murmurait quelque chose. Puis Gertie se glissa au dehors et disparut. Mais lui ne bougeait toujours pas.
- Master Val, dit une voix.
Il leva les yeux ; Masterman inspectait l'intérieur de
- Je m'assurerai qu'il ne reste rien, master Val.
Il gravit lentement les deux marches du porche ; le long corridor, brillamment éclairé, était vide. La porte du hall se referma. Il comprit que le chemin était libre. Ainsi donc, ils étaient partis, les uns et les autres, sans s'occuper de lui.
Il monta l'escalier et, en arrivant au dernier étage, il s'arrêta pour écouter ; n'entendant aucun bruit, il courut sur la pointe du pied comme quelqu'un qui se sent traqué, le long des petits couloirs et de la grande galerie, redescendit un étage et parvint à sa chambre. Tout en courant, il avait aperçu, dans l'embrasure d'une porte, une vieille figure coiffée d'un bonnet, mais il ne voulut pas la voir et ne s'arrêta pas. Il entra chez lui, s'enferma à double tour et se tint là, debout toujours, prêtant l'oreille...
...Il n'était encore qu'un enfant.
IV
L'horloge de l'écurie sonna dix coups. En arrivant dans sa chambre, trois quarts d'heure auparavant, il avait entendu la cloche qui annonçait le dîner des domestiques. Il avait fait un peu de toilette, mis ses souliers d'intérieur. Il éprouva presque de la reconnaissance en trouvant devant la cheminée des souliers, des chaussettes et de l'eau chaude. (Etait-ce Charles, le jeune valet de pied, qui avait eu cette idée ? ou Benty ?) Et il s'assit devant le feu, à songer.
La réalité était, en quelque sorte, cent fois pire que ce qu'il avait anticipé. Naturellement, il s'était imaginé des scènes diverses qui, toutes, se terminaient de la même façon : ses parents le chassaient. Il voyait bien tout le ridicule de ce dénouement, mais son imagination ne lui fournissait aucun autre moyen vraisemblable, pour son père, de résoudre
Un coup frappé à la porte le fit tressaillir.
- Qui est la ?
- C'est Masterman, master Val.
Il ouvrit la porte et se tint debout, comme barrant l'entrée, tenant dans sa main gauche, hors du rayon lumineux, un petit paquet d'où pendait un cordon ; il l'avait détaché de son cou en se déshabillant et, depuis, l'avait tenu presque inconsciemment serré dans sa main.
- Pardon, master Val, Madame demande si vous voulez bien descendre tout de suite manger quelque chose ; et quand vous aurez fini de souper, vous voudrez bien aller parler à Monsieur dans le fumoir.
Val fit signe que oui. Il voyait le vieux maître d'hôtel intrigué - à moins que lui aussi ne fût au courant de l'histoire et qu'elle n'eût fourni aux domestiques un sujet d'hilarité.
- Je vais descendre... Est-ce que les autres ont fini ?
- Oui, monsieur. Tout le monde est chez Madame. Miss Marjoribanks est montée se coucher.
- Très bien. Je descends.
Quand les pas se furent éloignés, il referma la porte à clef, alla de nouveau se placer devant la cheminée et demeura immobile. Pendant la première partie du voyage, il s'était décidé à une petite chose tragique et, sur le bateau, avait songé à l'accomplir. Mais il lui sembla qu'elle prendrait à Medhurst un caractère plus réfléchi, plus définitif... Donc, se trouvant seul dans sa chambre, il avait détaché de son cou le scapulaire contenant les lettres et le portrait de Gertie. Après l'avoir regardé quelques instants, il le pressa passionnément sur ses lèvres ; puis, avec précaution, le laissa tomber dans le cœur incandescent du foyer.
" Tout le monde est chez Madame ", avait dit Masterman. Val, en sortant de sa chambre, se rappelait ces mots. Et il se représentait nettement la scène : sa mère assise dans son fauteuil ; son père, debout devant la cheminée ; Austin, assis à côté de May, sur le sofa, et racontant l'histoire...
Dans la salle à manger, où il entra, trois personnes avaient soupé ; le quatrième couvert était intact. Ils avaient donc compté qu'il souperait avec eux ?
Il y avait du potage qui refroidissait. Il en prit un peu, tout en lançant des regards, par-dessus son épaule, vers la porte : il ne voulait pas être pris de court et changea de place afin de ne pas perdre de vue cette porte. Il mangea ensuite de la viande froide et but deux ou trois verres de vin. Pas un instant il ne cessa d'être aux aguets. L'heure était venue.
Pourtant, il resta là quelques minutes à manipuler son pain, les yeux fixés sur les tableaux d'ancêtres qui l'observaient. Il y en avait une douzaine, assez médiocres en comparaison de ceux qui formaient la précieuse collection du hall. Deux de ces portraits représentaient des hommes : l'un jeune, au visage doux, portait une armure, - il avait combattu à Naseby et y était mort âgé de dix-neuf ans ; l'autre, en perruque et en manchettes de dentelles, avait été blessé à Benheim en servant sous les ordres de Malborough... Son père lui avait plus d'une fois raconté l'histoire de ces héros, quand il était petit...
Enfin, sans se rendre compte qu'il avait pris la résolution de bouger, il se leva comme un automate, gagna la porte, l'ouvrit, sortit, traversa le hall dans toute sa longueur, la tête baissée, les yeux fixés à terre, posa la main sur le bouton de la porte du fumoir, la poussa sans avoir frappé, la referma derrière lui et se trouva face à face avec son père, qui le regardait.
Le général était assis près du feu, dans un fauteuil à haut dossier, la tête appuyée sur sa main. Une chaise était placée - intentionnellement, à n'en pas douter - devant
Val s'assit.
On ne saurait dire qu'il eût conscience de souffrir. Il existe un degré de douleur morale, comme de douleur physique, au delà duquel la réflexion sur cette même douleur devient intolérable. C'est dans cet état que se trouvait Val ; aussi, son attention se portait-elle sur des choses insignifiantes : il remarqua le reflet verdàtre de la lampe, abritée par son abat-jour, qui se jouait dans les cheveux d'argent du vieillard et les faisait briller, les rides et les ombres qui apparaissaient sur ses longues mains nerveuses, selon qu'il contractait ou étendait les doigts. La crainte habituelle, traditionnelle que lui inspirait son père était englobée dans une émotion plus générale...
Son père, après avoir toussé légèrement, prit la parole, et Val fut frappé de la sécheresse du ton. Une partie de lui-même, qui n'était pas l'attention proprement dite, recevait et enregistrait chaque mot.
- Je n'ai pas grand'chose à vous dire, monsieur. J'ai décidé de vous faire l'honneur de croire encore qu'il n'en est pas besoin. C'est surtout de l'avenir que je vais vous parler.
Il se tut et avala sa salive.
- Nous avons causé, votre mère et moi, de toute cette affaire. Nous savions, bien entendu, par les lettres, ce qui s'était passé et nous venons d'en apprendre les derniers détails. Votre frère a dit tout ce qu'il pouvait dire en votre faveur ; il nous a affirmé que vous paraissiez vraiment malade ; il a fait son possible pour vous défendre. Je ne sais pas jusqu'à quel point ses arguments peuvent vous constituer une excuse. Je renonce à vous comprendre, ainsi que votre code d'honneur. May a également plaidé pour vous. Et voici notre décision. Désormais, je défends qu'il soit dit à aucun être vivant un mot sur ce sujet ; quand j'aurai fini d'en parler ce soir, je n'y ferai plus jamais allusion, ni à vous ni à qui que ce soit. Votre mère, Austin et May imiteront mon silence. May est en ce moment avec miss Marjoribanks ; elle lui fait part de notre décision et lui demande de s'y conformer. Et j'attends de vous - c'est un ordre - que vous vous y conformiez aussi. Vous ne discuterez plus sur cette matière avec qui que ce soit, - même pas avec Austin. En ce qui concerne les paroles, voilà qui est réglé.
" Pour ce qui est des actes, je ferai ce qui me paraît bien. Je ne dis pas que je vous exclurai de la maison ou que je vous retirerai de Cambridge. Les choses continueront comme par le passé. Votre disgrâce ne sera pas publique. Mais si, parfois, vous avez des raisons de penser que je vous traite sévèrement ou que je vous témoigne un manque de confiance, vous voudrez bien vous rappeler pourquoi. Me comprenez-vous ?
- Oui.
- Avez-vous quelque chose à me dire ?
- Non.
- Vous partirez demain matin par le train de neuf heures quinze et vous vous rendrez directement à Cambridge. Vous déjeunerez donc seul. Quand nous nous reverrons, aux vacances prochaines, l'ancienne vie reprendra son cours, autant qu'il sera possible.
Il s'arrêta.
Puis, il appela vivement, à haute voix :
- Béatrice !
La porte du petit salon de lady Béatrice s'ouvrit et Val vit entrer sa mère. Elle s'avança calme, droite et magnifique ; mais sa main tremblait un peu sur sa canne. Val se leva et attendit.
- Béatrice, je viens de lui parler. A partir de ce moment, plus un mot ne sera prononcé sur cette affaire. Et il faudra qu'il rachète son honneur, du mieux qu'il pourra.
Le vieillard se tourna vers Val.
- Bonne nuit, dit-il. Embrassez votre mère. Alors, lady Béatrice entoura de ses bras le jeune homme, qui fondit en larmes.

Loading
|

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.